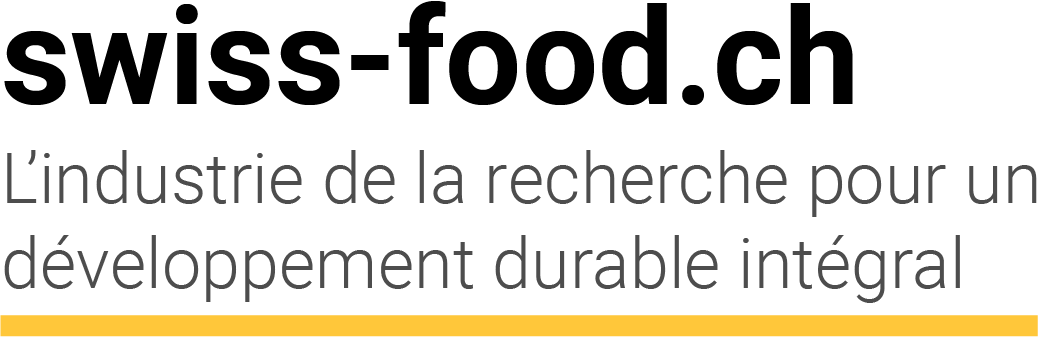«Les pesticides sont de plus en plus toxiques»
Non, c’est le contraire. Les produits phytosanitaires sont devenus de plus en plus sûrs au cours des dernières décennies. Les nouvelles substances actives sont soumises à une procédure d’approbation extrêmement sévère. Règle absolue: ne pas mettre en danger l’être humain et l’environnement. La direction suivie est la bonne. Les données disponibles attestent que les produits phytosanitaires sont devenus en vingt ans non seulement plus sûrs, mais aussi plus respectueux de l’environnement.
mercredi 31 mars 2021
Les faits essentiels en bref
- Les produits phytosanitaires présentant un potentiel de risque particulier sont de moins en moins autorisés.
- Il s’en vend également de moins en moins. La toxicité aiguë des produits phytosanitaires a diminué. Les quantités de substances actives utilisées pour obtenir le même effet protecteur sont en constante baisse.
- Il est faux de prétendre que les produits phytosanitaires sont de plus en plus toxiques.
Les anti-pesticides aiment bien faire croire que «les produits phytosanitaires sont de plus en plus toxiques». Cette impression est fausse. Une série de données prouve que depuis les années 1960, d’énormes progrès ont été accomplis. Les quantités de substances actives utilisées par hectare ont reculé de plus de 90% depuis 1962. Autrefois, un agriculteur avait besoin de 10 kilos environ d’une substance active par hectare. Aujourd’hui, cette quantité est descendue à moins de 1 kilo.
Des produits toujours plus sûrs
Simultanément, les nouvelles substances actives sont devenues de plus en plus sûres, comme le confirme la statistique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’OMS subdivise les produits phytosanitaires en quatre classes. Classe 1: très dangereux; classe 2: modérément dangereux; classe 3: légèrement dangereux; classe U: peu susceptibles de présenter un danger aigu. Depuis l’an 2000, aucune nouvelle substance de classe 1 n’a été autorisée. La moitié de toutes les nouvelles substances autorisées sont des produits phytosanitaires de classe U. Depuis les années 1960, la toxicité aiguë a diminué de 40%.
L'éclairage
Réduire les risques
Cette évolution se reflète également dans la statistique des ventes de l’Office fédéral de l’agriculture. La statistique montre que la vente des produits phytosanitaires qui présentent un potentiel de risque particulier a reculé de 35% dans l’agriculture conventionnelle durant les dix dernières années. La part des produits phytosanitaires présentant un potentiel de risque particulier dans le total des ventes se monte à 11%. Le cuivre s’en accapare 34%, ce qui le fait arriver loin devant. Les agriculteurs bio aussi emploient des produits à base de cuivre. Dans l’agriculture conventionnelle, en revanche, les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires reculent depuis des années. La direction suivie est la bonne.
Articles similaires

Pourquoi l'IA n'a pas encore fait sa percée dans l'agriculture
L'intelligence artificielle a le vent en poupe dans de nombreux domaines. Mais dans l'agriculture, la nouvelle technologie ne semble pas encore être vraiment arrivée. La faute à la nature, qui met des bâtons dans les roues de l'IA. Néanmoins, les opportunités que l'IA pourrait offrir à l'agriculture seraient immenses.

Alimentation: l’avenir appartient-il aux ciseaux génétiques verts?
De nouvelles variétés végétales contribuent à la sécurité de l’approvisionnement. Les nouvelles techniques de sélection végétales connues sous l’appellation de «ciseaux génétiques», tels que Crispr, ont le potentiel de révolutionner l’agriculture et l’alimentation.

Les produits régionaux sont plus demandés que jamais
La demande en produits régionaux ne pourrait pas être plus grande. C'est ce que montre une nouvelle étude de la Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Les consommateurs estiment même que les produits régionaux sont nettement plus durables que les produits bio ou premium.

Tomate: de la «bombe à eau» au fruit aromatique
Jamais encore le choix de variétés de tomates n’avait été aussi vaste.