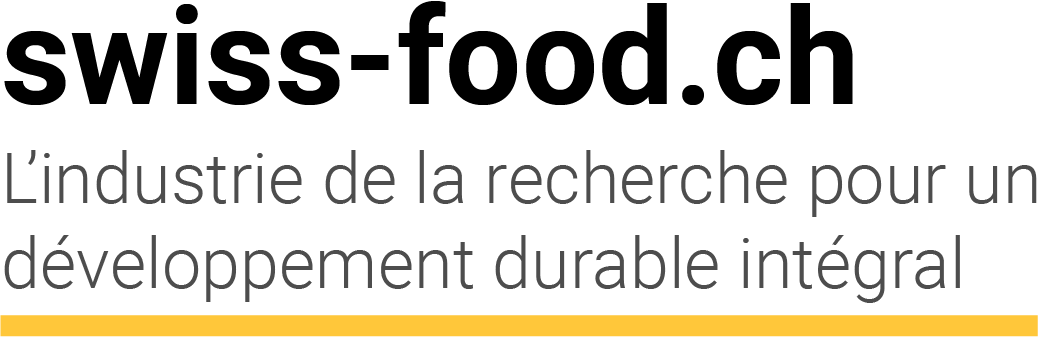Renoncer au colza suisse?
Le colza est la principale plante oléagineuse de Suisse, et son importance ne cesse d’augmenter. L’huile qui en est tirée remplace de plus en plus souvent l’huile de palme, importée et impopulaire. Sans les produits phytosanitaires de synthèse, cultiver du colza en Suisse serait impossible. Le colza est important aussi bien pour les consommateurs et les fabricants de nombreux produits suisses que pour les abeilles locales. Pour elles aussi, le colza est une source importante d’alimentation.
jeudi 10 juin 2021
En Suisse, le colza couvre un quart des besoins en huile végétale. Environ 6500 exploitations agricoles cultivent du colza sur 23 000 hectares (l’équivalent environ de 32 000 terrains de football). La culture du colza en Suisse est cependant ardue. Car le colza est une plante sensible. Pour cette raison, 1,5% seulement de toute la surface cultivée en Suisse est plantée en bio. Une culture totalement «libre de pesticides» serait impossible dans les quantités et la qualité requises.
Si le colza venait à disparaître en Suisse, les abeilles seraient aussi touchées. Au printemps, le colza représente leur principale source de pollen et de nectar. En outre, la récolte massive du colza stimule le développement des colonies et favorise aussi l’essaimage.
Pression élevée des ravageurs
En automne, c’est surtout l’altise du colza qui menace la plante oléagineuse après les semis. Le colza est également sensible aux limaces. Au printemps, il est attaqué par le charançon de la tige du colza, qui pique les tiges de colza pour y déposer ses œufs. Les dégâts aux cultures sont alors considérables et peuvent entraîner une baisse des rendements de 30%. Le coléoptère luisant du colza s’attaque lui aux boutons floraux non éclos. Face à ces multiples menaces, l’utilisation de produits phytosanitaires est indispensable.
L’huile de colza remplace peu à peu l’huile de palme
Sans pesticides, la culture du colza en Suisse serait inimaginable. Les fabricants de denrées alimentaires qui se sont engagés à passer à l'huile de colza suisse pour leurs produits devraient à nouveau modifier leurs plans. Parmi elles, on trouve par exemple Zweifel, qui élabore ses chips exclusivement avec de l’huile de colza suisse. Ou Wander, le fabricant d’Ovomaltine. L’huile de palme contenue dans la pâte à tartiner «Ovomaltine Crunchy Cream» a été remplacée par de l’huile de colza suisse. Sans produits phytosanitaires appropriés, les deux entreprises devraient probablement revenir à l'huile de tournesol ou à l'huile de palme.
Un usage multiple
Mais le colza ne sert pas qu’à faire de l’huile de table. Il rend aussi d’éminents services dans l’agriculture. Les résidus de presse des graines de colza contiennent beaucoup de protéines et une composition favorable d’acides aminés. C’est pourquoi, aujourd’hui déjà, il arrive qu’on s’en serve comme aliment concentré dans l’élevage. Comme les plantes contiennent cependant d’importantes quantités d’acide phytique aux propriétés antinutritionnelles, leur usage comme fourrage est limité. La solution pourrait venir de l’édition génomique. À l’aide des ciseaux CRISPR/Cas9, des chercheurs ont réussi à réduire sensiblement la teneur en acide phytique dans les graines de colza. Grâce à cette technique, on pourrait produire plus d’aliments concentrés en Suisse et diminuer les importations de fourrage. Dans l’agriculture bio, l’huile de colza est utilisée comme produit phytosanitaire pour son action insecticide. Ce colza est issu de cultures conventionnelles où l’utilisation de pesticides de synthèse est indispensable.
La demande dépasse l’offre
Les consommateurs veulent de l’huile de colza suisse. Durant ces dernières années, la demande a augmenté sans discontinuer. La demande en huile de colza dépasse de beaucoup la production. En Suisse, le taux d’autoapprovisionnement en huile de colza atteint environ deux tiers. Et le marché mondial aussi est à sec. Malgré son prix élevé, le colza n’est guère disponible en ce moment. Les agriculteurs suisses ne sont pas en mesure de cultiver plus de colza. Depuis 2014, il est interdit de traiter les semences aux néonicotinoïdes. Depuis, malgré la hausse de la demande et de la surface cultivée, la quantité produite stagne. Ceux qui demandent de remplacer l’huile de palme devraient logiquement demander de pouvoir utiliser les pesticides de synthèse. Car sans la protection des plantes, la culture de colza en Suisse disparaîtrait.
Grandes pertes avec le colza bio
Comme l’écrit le Schweizer Bauer, le colza bio, qui est plutôt un marché de niche, a déjà subi de lourdes pertes en 2021. «Nous avons reçu diverses annonces de perte totale de récolte. Selon nos calculs, entre un tiers et la moitié de la surface devrait manquer, principalement à cause de l’altise du colza et du charançon de la tige du colza. Le colza bio serait pourtant très demandé», déplore Andreas Rohner, responsable du ressort Matières premières bio chez Fenaco. Ces dégâts importants ont plusieurs causes possibles, comme l’explique Hansueli Dierauer du FibL: l’extension des surfaces plantées en colza, des hivers plus doux, une arrivée toujours plus précoce du charançon de la tige du colza et l’interdiction des néonicotinoïdes en culture conventionnelle. «Nous n’avons pas de solution pour le moment», regrette-t-il. «Soit l’écosystème revient à l’équilibre, soit la culture bio disparaîtra. Une solution biologique contre le charançon de la tige du colza n’est pas pour demain. Notre dernier espoir repose sur le développement de nouveaux systèmes de culture que nous expérimenterons dès l’automne. En attendant, la culture de colza bio se déplacera dans les régions plus favorables où la pression des ravageurs est moindre.»
C’est un fait: les plantes utiles sont constamment menacées. La lutte ciblée contre les ravageurs est une nécessité. Si l’on ne peut pas protéger les cultures, le rêve de l’huile du terroir se transforme rapidement en cauchemar. Pour un agriculteur, une récolte perdue, c’est un revenu qui s’évanouit et des terres agricoles qui sont gaspillées.
Cela ne signifie pas que la recherche ne doit pas continuer à chercher dans toutes les directions, tant s’en faut. Le défi est de réussir le grand écart: préserver les sols et la biodiversité, protéger le climat et produire suffisamment de nourriture pour dix milliards d’êtres humains. Pour offrir aux dix milliards d’habitants sur terre une vie aussi digne que possible, avec les libertés de choix que nous connaissons. Seule une agriculture qui est durable dans chacune des trois dimensions peut relever ce défi. Cela suppose des discussions honnêtes sur la base des preuves scientifiques et une volonté de trouver des solutions de la part de toutes les parties. Parmi ces solutions, citons pêle-mêle: la numérisation dans la recherche et la détection des infestations, les méthodes de sélection telles que les ciseaux CRISPR/Cas, l’amélioration des connaissances sur les interactions dans le sol et la recherche menée par l’industrie pour trouver de nouveaux actifs biologiques et de synthèse et les appliquer de manière toujours plus précise. Des plantes rendues résistantes à l’aide des ciseaux CRISPR/Cas peuvent certes contribuer à réduire sensiblement les produits phytosanitaires, mais elles ne les remplaceront jamais totalement. Car il n’existe aucune plante résistante pour toujours et, surtout, contre chaque maladie ou parasite possible. Les solutions sont interactives, complexes, multidimensionnelles. L’agriculture aura besoin de tous les outils disponibles pour être capable de produire en faisant une utilisation efficiente des ressources. Nous ferions bien de la soutenir: nous devons tous manger.
Sources
Articles similaires

Pourquoi l'IA n'a pas encore fait sa percée dans l'agriculture
L'intelligence artificielle a le vent en poupe dans de nombreux domaines. Mais dans l'agriculture, la nouvelle technologie ne semble pas encore être vraiment arrivée. La faute à la nature, qui met des bâtons dans les roues de l'IA. Néanmoins, les opportunités que l'IA pourrait offrir à l'agriculture seraient immenses.

Alimentation: l’avenir appartient-il aux ciseaux génétiques verts?
De nouvelles variétés végétales contribuent à la sécurité de l’approvisionnement. Les nouvelles techniques de sélection végétales connues sous l’appellation de «ciseaux génétiques», tels que Crispr, ont le potentiel de révolutionner l’agriculture et l’alimentation.

Les produits régionaux sont plus demandés que jamais
La demande en produits régionaux ne pourrait pas être plus grande. C'est ce que montre une nouvelle étude de la Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Les consommateurs estiment même que les produits régionaux sont nettement plus durables que les produits bio ou premium.

Tomate: de la «bombe à eau» au fruit aromatique
Jamais encore le choix de variétés de tomates n’avait été aussi vaste.